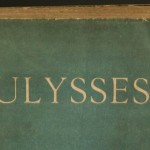Antonin Artaud a quitté ce monde le 4 mars 1948. Il est, de tous les écrivains français, probablement le plus radical dans son projet de transformer l’écriture littéraire, la scène théâtrale et même l’art cinématographique. Sa vie, son œuvre, témoignent de cette folle entreprise et nous laissent des chefs-d’œuvre inoubliables comme sa reprise du « Moine » de Lewis, « L’ombilic des limbes », « le théâtre et son double » – traité incontournable sur la scène théâtrale. Ses apparitions sur les écrans de cinéma, comme dans « la passion de Jeanne d’Arc » de Dreyer ou le « Napoléon » d’Abel Gance sont des moments aussi hallucinés qu’hallucinants. La folie, puis la maladie feront de sa fin de vie un cauchemar.
« J’ai choisi le domaine de la douleur et de l’ombre comme d’autres celui du rayonnement et de l’entassement de la matière. Je ne travaille pas dans l’étendue d’un domaine quelconque. Je travaille dans l’unique durée. »
L’ombilic des limbes. 1925
Source : la cause littéraire.
À lire impérativement : le Théâtre et son double, essai dans lequel Artaud définit le « théâtre de la cruauté » !